- L’Òrle dei matins – L’Ambre, Perpignan, Trabucaire, 1996, 102 p.
Commander l'ouvrage aux éditions Trabucaire : http://www.trabucaire.com/
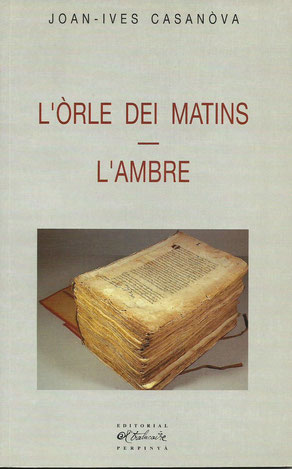
Un jorn benlèu, lòng, tan duradís coma una renada d’agònia, fòra d’enòdi e de lutz umana, vos levaretz per me prene dins la nuech, me pausar la man sus la boca, e coma de raubaires partirem atalentats de sospirs per fugir un malastre encara endurmit. Ai primiereis oras dau jorn, serem totei dos solitaris e glaçats. Un jorn benlèu vos trobarai mòrta dins la cambra, leis uelhs duberts, espaventada de la luciditat d’un instant retrobada. De qué servirián lei mots deis òmes ? De dire que lo malastre nos es vengut, causida de Dieu ? Ajaçada sus lo freg de la tèrra, sentiretz quasi ren, una aura vos frustar de seis alas d’àngel. Ieu, ai ribas de l’amor, partirai per esperar la fin dau jorn. Luenh, la campana dei mòrts. Cresi pas a l’eternitat deis òmes dins lo mond de Dieu. Ailà, la vida es autra. Es luenh dins la nuech e siáu tardier per lo remembre. Me’n vau vos retrobar dins l’imatge dau sòmi. Passant au ras de la pòrta, ausirai lo respir cortet dau sòm vòstre. Pausarai ma man, coma per intrar, mai sabi que partirai, encara un còp despoderós de vòstre amor. Vos ai tant aimada. L’ombra de la nuech s’ajaçarà a mon canton. Dau temps de mon respir, vòstrei labras a mon sòmi, esperarai encara lo jorn nòu dins un infern de paraulas. En fin dau camin de tèrra, lei caras que s’alunhan demòran desparaulablas. Son lei lònas dau remembre. En riba dau crit e dei plors, vos sauprai reconéisser, vestidas de faudas blancas, e, òme desalenat, me restarà que la lenga que crida.
Un jour, peut-être, long et éternel comme un râle, hors de l’ennui et d’une lumière humaine, vous vous lèverez pour me chercher dans la nuit, poser votre main sur ma bouche, et nous partirons comme des voleurs affamés de soupirs pour fuir un malheur encore endormi ; nous irons tous deux solitaires et glacés aux premières heures du matin, un jour, peut-être, vous trouverais-je morte dans la chambre, les yeux ouverts, épouvantée d’une lucidité un instant retrouvée. À quoi serviraient donc les mots des hommes ? À dire que le malheur nous a été donné par le choix de Dieu ? Étendue au froid de la terre, vous ne sentirez presque rien, une brise vous frôlera de ses ailes d’ange, tandis qu’épuisé aux clairières de l’amour, je partirai pour attendre la fin du jour, et, au loin, résonnerait le glas ; je ne crois pas à l’éternité des hommes dans le monde de Dieu. Là-bas, la vie est autre. La nuit est avancée et il est trop tard pour le souvenir ; je vais vous retrouver dans l’image du rêve : en passant près de la porte, j’écouterai le souffle court de votre sommeil, je poserai ma main comme pour entrer, mais je sais que je me retirerai encore une fois dépossédé de votre amour. Je vous ai tant aimée. L’ombre de la nuit s’étendra à mon côté. Dans un souffle, vos lèvres dans mon rêve, j’attendrai encore le jour nouveau dans un enfer de paroles. Au bout du chemin de terre, les visages qui s’éloignent demeurent indicibles ; ils figurent impassibles les étangs du souvenir. Au bord du cri et des pleurs, je saurai vous reconnaître, vêtues de robes blanches, et, homme essoufflé, je ne serai que cette langue qui crie.